
Le manque de confiance, pilier du micromanagement
Dans un précédent article Les ravages du micromanagement : reconnaître le Mal, je te décrivais en détail en quoi consiste le micromanagement et ses conséquences désastreuses sur toi, tes collaborateurs et ton entreprise.
(si tu préfères écouter le podcast, c’est par ici)
Le manque de confiance, fréquent chez les patrons de TPE-PME
Quand tu donnes du tac au tac la réponse à un salarié venu te voir avec une question, ce n’est pas simplement un mauvais réflexe. C’est avant tout l’expression d’un manque de confiance.
C’est une situation particulièrement fréquente dans les TPE-PME dont le patron a démarré seul. C’est logique.
Pour bien comprendre sur quoi repose ce manque de confiance, je te propose de remonter un peu le temps.
A l’origine de l’entreprise, il y a toi qui l’a fondée. Tu as commencé seul, ou avec un associé. Le business plan, c’est toi qui l’a écrit et défendu pendant de longs mois. Il reflète tes convictions sur ce qui doit être fait, pourquoi et comment cela doit être fait. La plupart du temps, ton avis sur le sujet repose sur une expérience solide dans le domaine en question : tu as travaillé dans une branche similaire, cela correspond à ta formation initiale, à ton parcours.
Tu n’as donc pas imaginé les choses comme cela par hasard. Tu sais de quoi tu parles.
Puis tu as créé la boîte. Et pendant plusieurs mois, voire pendant plusieurs années, tu as fait les choses seul. Tu as enchaîné les heures de travail et tu t’es coltiné les 360 degrés de tout ce qui peut concerner une entreprise.
Tu as déroulé ton business plan… ou pas. Mais toujours à ta façon, selon tes convictions et ton savoir-faire. Tu ne t’en es pas bien rendu compte, mais tu as développé une multitude de petits « process » personnels, plein de petites manières de faire les choses, faire 36 choses, toutes en même temps bien souvent.
C’est ce qui t’a permis de survivre et d’arriver à un stade où tu peux te permettre de recruter, et où tu sens de toute façon que tu dois le faire sous peine de ne plus avancer ou de devenir dingue. Ces premières étapes franchies, ce stade où tu es arrivé et qui te permet de recruter, tu l’attribues à ta manière de faire les choses. La situation favorable dans laquelle tu te trouves est en quelque sorte une validation de ta manière de faire.
Un manque de confiance présent dès le recrutement
Quand tu recrutes, c’est presque toujours pour confier à quelqu’un des tâches que jusqu’ici tu réalisais toi-même. Parfois depuis longtemps. Pour te délester, parce que tu sens que tu pourrais mieux avancer en consacrant davantage de temps à ta valeur ajoutée.
Tu as donc bien réfléchi à ce que tu veux déléguer. Tu as pris une feuille de papier et dressé une liste de tâches qui mises bout à bout, forment un poste. Tu as d’ailleurs eu un sourire jusqu’aux oreilles quand tu as estimé le temps que te prennent ces tâches, que tu as tout additionné et que tu vois combien de dizaines d’heures hebdomadaires ton nouveau salarié va t’épargner. Et comme ça ne fait pas forcément 35 h hebdo, en plus, ton nouveau salarié pourra même prendre quelques initiatives supplémentaires. Super ! Tu pourras soit souffler un peu, soit enfin avoir le temps de reprendre en main plusieurs projets qui étaient en suspens tant que tu n’avais pas retrouvé un peu de disponibilité.
Inévitablement tu as un avis très tranché sur la manière dont les choses doivent se passer et sur ce que ton salarié doit faire… et comment il doit le faire.
Et comment il doit le faire ? A ta façon. C’est bien cela être « décideur », non ?
Alors te voilà avec ton salarié. Tu lui expliques tout ce qui doit être fait et comment ça doit être fait. Tu y passes beaucoup de temps. Ça part d’un bon sentiment, il s’agit de le mettre dans les meilleures dispositions. Et puisque depuis le début tu as développé tous ces trucs et astuces sur tous les sujets, tu lui fais gagner du temps en partageant tes méthodes. Pas la peine que ton salarié se donne la peine de réinventer la roue, il n’a qu’à faire tout comme toi tu le faisais.
L’enfer est pavé de bonnes intentions
Voilà que les semaines passent et que tu n’es pas satisfait. Non seulement ton salarié n’arrive pas à faire ce que tu lui demandes, mais en plus, il ne prend aucune initiative. Il n’en a de toute façon pas le temps, puisque tout semble lui prendre deux fois plus de temps que quand c’était toi qui le faisait. Tu ressens un grand manque de confiance envers lui, mais c’est un sentiment qu’il partage : ton collaborateur éprouve lui aussi un manque de confiance… en lui.
Avant de te demander si tu es tombé sur un collaborateur incapable ou bouché, commence par analyser la manière dont tu opères avec lui.
Rappelle toi que tu lui as dit tout ce qui devait être fait mais aussi comment le faire.
Il faut bien évidemment passer certaines consignes, mais ce faisant on transmet telle quelle une manière de faire et l’on entérine sans y réfléchir le fait que c’est la seule façon de faire.
Quelle est l’impression laissée à ton salarié en lui expliquant par le menu tout le mode d’emploi de son poste ? Pendant que tu t’auto-congratules de ton talent de formateur, ton salarié a l’impression qu’il n’y a qu’une seule manière de faire les choses : la tienne.
Il n’aura qu’une préoccupation : ne pas te décevoir. Et comme tu sembles attacher plus d’importance à la méthode qu’au résultat, pour ne pas te décevoir il ne dérogera pas à la méthode. Pas d’un pouce. Tant pis si elle ne lui convient pas. Tant pis si elle est obsolète.
Es-tu bien certain que toutes ces tâches que tu as transférées à ton salarié sont encore judicieuses ? Ce que tu faisais toi-même manuellement ne peut-il pas être automatisé, par une application ou un logiciel ? Est-il encore nécessaire de le faire ?
Recruter, c’est l’occasion de dépoussiérer
Voici un exemple : je passais énormément de temps à répondre aux questions posées par mail, par des clients qui voulaient plus d’informations sur mes produits. Je connaissais mes produits par coeur et je trouvais important d’apporter des réponses précises, voire personnalisées, à mes clients. A mesure du développement des ventes, il m’est devenu impossible de continuer à répondre ainsi aux clients.
En confiant cette tâche à une collaboratrice, le risque était que les réponses apportées soient, selon moi, moins qualitatives que les miennes. Et de toute façon, les volumes progressant, ce n’était qu’une question de temps avant d’avoir de nouveau un trop plein de travail impossible à traiter.
La solution a été de revoir toute la trame des fiches produits sur mes sites web, de façon à ce qu’elles contiennent beaucoup plus d’informations et que les internautes trouvent plus facilement ce qu’ils sont venus chercher.
Plus les gens trouvent d’informations sur la page produit, moins ils ont de questions à poser appelant une réponse personnalisée. Et quiconque répond aux mails des clients peut tout simplement proposer des liens vers les contenus pertinents. On couvre ainsi la plupart des questions basiques. A mesure que de nouvelles questions nous sont posées, nous enrichissons nos pages web. Par ailleurs, c’est excellent pour le référencement naturel de nos sites puisque nous augmentons de jour en jour notre quantité de contenu pertinent.
Les réponses sont-elles moins qualitatives qu’avant ? Ça dépend à qui l’on demande. Moi, il m’arrive de penser qu’il manque une phrase, un détail supplémentaire, ou ma « patte »… mais ce qui constitue pour moi une réponse qualitative est peut-être très éloigné de ce qui satisfait mes clients. A vouloir être trop précis dans mes réponses, je deviens barbant et trop long à lire. Je peux donner l’impression à des clients que leur problème est beaucoup plus complexe qu’il ne l’est, la plupart de mes clients n’étant pas des spécialistes du sujet. Ils semblent très à l’aise avec une réponse concise agrémentée de liens vers des contenus structurés. C’est la progression de nos ventes qui me le prouve.
Par ailleurs, le fait de recevoir moins de questions basiques fait naturellement émerger les questions plus pointues. On n’hésite pas, aujourd’hui, à rebondir sur ces questions pour tourner de courtes vidéos dans lesquelles on y répond face caméra. Nos clients apprécient énormément cette transparence, le format vidéo agréable et rapide à consulter, le fait de voir nos visages. Et comme ce sont des formats faciles à partager sur les réseaux sociaux, nous augmentons peu à peu notre visibilité sur différentes plateformes.
Je préfère payer un salarié à concevoir ces vidéos pertinentes, que le payer à répondre inlassablement les mêmes phrases clés dans des tickets techniques.
Il peut donc être très utile de se demander avant tout si ce que l’on s’apprête à déléguer est toujours indispensable, ou si l’on peut faire mieux. Une fois de temps en temps, c’est l’occasion de faire le point sur l’évolution de l’activité et de dépoussiérer les manières de faire et voir les choses.
Le fameux manque d’initiative…
Quand j’entends des chefs d’entreprise se plaindre de l’absence de prise d’initiatives chez des salariés, je me rends souvent compte en creusant un peu que le chef d’entreprise a une fâcheuse tendance à revenir sur des tâches déjà effectuées. Le motif invoqué ? « Il m’a fait ça n’importe comment ».
Bien sûr, il y a des gens qui font effectivement « ça n’importe comment ». Mais il y a bien souvent aussi des gens qui font juste ça différemment. Ce que leur responsable ne supporte pas. Faire correctement, c’est « faire comme moi je fais ».
On entre alors dans le cercle vicieux : les choses ne sont pas faites comme moi je les ferais, alors je repasse derrière et je refais. Mon salarié a l’impression d’être idiot, ressent mon manque de confiance en lui, et perd confiance en ses propres capacités.
Vu du côté du patron, j’ai entendu des chefs d’entreprise me dire « de toute façon je repasse toujours derrière lui parce qu’on ne peut pas lui faire confiance. Si je ne suis pas constamment derrière c’est la cata, et il ne prend aucune initiative. Il vient sans arrêt me voir pour que je valide son travail.»
Vu du côté du salarié, j’ai aussi souvent entendu : « quoi que je fasse il repasse derrière moi. Je dois vraiment être nul. Du coup je préfère ne plus toucher à rien jusqu’à ce qu’il me dise exactement ce que je dois faire et comment. Et pour m’éviter toute mauvaise surprise je l’invite constamment à vérifier si ce que j’ai fait est bon, pour qu’il ne vienne pas râler après. » (ponctué par le comble du comble : « comme ça tu comprends, on gagne du temps ! » alors que c’est précisément l’inverse qui se produit).
Ton salarié ne prend alors plus aucune initiative et n’a plus d’avis sur comment les choses devraient être faites. Parce qu’il finit par penser que si on manque de confiance en lui, c’est qu’il n’en est pas digne.
Et ça, c’est dans le meilleur des cas.
Dans le pire des cas, il peut aussi prendre sérieusement ombrage de ton attitude et se dire : « il repasse derrière moi constamment, comme si j’étais un bon à rien. Sa façon n’est pourtant pas meilleure que la mienne. Mais pour qui se prend-il ? A la première occasion, je m’en vais. »
On nage en plein malentendu ! Le micromanagement, par le manque de confiance dont il témoigne, fait donc fuir toutes les personnes valables, expérimentées et compétentes.
Une astuce particulièrement puissante : l’absence virtuelle
Et faut-il encore qu’on laisse le collaborateur prendre des initiatives en présence de son patron… si tu mets ton nez dans tout ce qu’il fait toute la semaine, il ne prendra évidemment plus aucune initiative. En ton absence en congés ou en déplacement, bien sûr, il n’aura plus le poids de ta présence sur les épaules et tu attendras de lui qu’il prenne des initiatives… sauf qu’il n’en a absolument pas l’habitude puisque tu passes ton temps à tout vérifier !
Quand tu t’absentes, attendre des initiatives fabuleuses d’un collaborateur que tu ne laches pas d’une semelle en temps normal, est à peu près aussi réaliste que de vouloir apprendre à nager à quelqu’un en le jetant dans 3 mètres d’eau à la première occasion. Il faut donc commencer par organiser ton « absence virtuelle » du bureau, c’est à dire être absent tout en étant présent.
Le mode avion sur un téléphone, ça existe. Une porte de bureau, ça peut se fermer. Des consignes pour n’être dérangé sous aucun prétexte, ça se donne.
Cela te permettra d’une part de retrouver un peu de « bande passante », c’est à dire une certaine qualité de temps de travail, pour te concentrer sur des choses fondamentales. D’autre part, cela te permettra de tester « à blanc », sans risque majeur, les situations qui se présentent et les décisions susceptibles d’être prises en ton absence.
Ceci te donnera la petite touche de « contrôle » qui te rassurera si tu en as encore besoin.
Mais cela aura aussi le mérite d’activer la touche « confiance » auprès de tes collaborateurs. Quand ils se seront rendu compte qu’ils peuvent parfaitement gérer les choses sans te déranger et sans créer de cataclysme majeur, ils seront beaucoup plus confiants pour faire de même à ta prochaine véritable absence.
Derrière le manque de confiance : la peur panique de l’erreur
Derrière ce manque de confiance, il y a ta pire crainte : si tu ne lui dis pas comment faire, il va se tromper.
C’est probable.
Et toi, tu ne te trompes jamais ?
Sans doute que si.
Mais moins souvent.
Admettons.
Mais si ton salarié se trompe, que se passera-t-il, réellement ? Des vraies erreurs totalement irrattrapables, est-ce que ça existe ? Qu’y a-t-il, au pire, qui ne peut pas être rattrapé par un mail ou un coup de fil, si vraiment le collaborateur a fait une boulette ?
Pose-toi sincèrement et sereinement ce genre de question. Tu vas vite te rendre compte que des erreurs vraiment irrémédiables il n’y en a pas tant que ça, s’il y en a.
Et puis s’il existe un domaine de tâches dans lequel il peut y avoir des erreurs très lourdes de conséquences, il te suffit de passer davantage de temps sur ce domaine et de mettre en place une double-vérification sur ce sujet-là uniquement. Mais ne sape pas la totalité des initiatives de ton salarié dans tous les domaines, sous prétexte d’un manque de confiance sur un seul sujet plus sensible que les autres.
Et en cas d’erreur de ton salarié, tu auras l’occasion de débriefer son erreur avec lui et de la lui faire comprendre. Ce sera beaucoup plus didactique et enrichissant pour lui que de rester dans un manque de confiance permanent et de se voir constamment indiquer comment faire les choses avant même qu’il ait eu la possibilité de se tromper.
On en revient à ce qu’on disait dans le précédent podcast : débriefer avec lui son erreur, c’est l’occasion de lui apprendre à pêcher plutôt que de continuer à lui fournir du poisson tous les jours. Tu sais, toutes ces belles citations sur le leadership et sur le fait qu’on apprend de ses erreurs, que tu approuves sans réserves sur Linkedin ? On y est.
Fais ça, et tu verras qu’assez rapidement il ne se trompera pas tellement plus que tu ne te tromperais… voire beaucoup moins.
D’autant qu’en ayant plus de liberté sur son poste, il va apprendre plein de choses que tu n’avais plus le temps d’apprendre. Trouver des astuces, identifier des outils pour aller plus vite, identifier des prestataires qui changent la vie, bref, il va devenir un professionnel à son poste.
Et rapidement, ses décisions seront meilleures que les tiennes. Pourquoi ? Parce qu’elles seront mieux éclairées, mieux informées. Normal : lui passe sa journée sur le sujet en question, toi non.
Avoir des salariés ou avoir une équipe ?
Tu entreras alors dans la phase la plus exaltante du management : laisser travailler tes collaborateurs qui se tromperont désormais moins souvent que toi. Les laisser te dire de quoi ils ont besoin, de qui, de quels outils, plutôt que de continuer à l’imaginer à leur place. Laisse-les rencontrer eux-mêmes les prestataires, synthétiser et choisir la meilleure solution parmi plusieurs. Définis une enveloppe budgétaire, et laisse-les arbitrer. De temps en temps si le coeur t’en dit, demande-leur une explication sur leur choix. Tu seras bluffé par sa pertinence.
Je vais te raconter une anecdote personnelle à ce sujet : la première année d’existence de ma société, j’ai pris une alternante. Et en même temps, pour faire bouillir la marmite et repousser au maximum le moment où j’allais devoir me payer, j’ai pris un poste de professeur associé à mi-temps à La Sorbonne. Je donnais donc des cours à Paris chaque lundi. Habitant à 200 km de Paris, je partais très tôt le matin, je revenais à mon bureau seulement en fin d’après-midi et je n’étais pratiquement pas joignable de la journée.
Les premiers temps, ma collaboratrice m’attendait le lundi soir avec une pile de messages en tous genres. Bien souvent on commençait donc la semaine avec un jour de retard sur beaucoup de sujets, et des clients pas ravis.
Rapidement j’ai donc travaillé avec ma collaboratrice sur la distinction entre l’urgent et le non-urgent, et l’ai invitée à réfléchir à comment gérer les principales urgences en mon absence. Avec le manque de confiance lié à la jeunesse et l’inexpérience, sa première réaction a été de me dire « Mais je vais faire des erreurs ! ».
Ma première réponse a été le raisonnement suivant : « Admettons que sur 100 décisions, tu feras 10 erreurs là où moi j’en ferai 5. Tu feras donc 5 erreurs de plus que moi. La plupart du temps, aucune de ces erreurs ne sera irrattrapable. Et ces 5 erreurs de plus, c’est le prix à payer pour que tu puisses trancher correctement 90 décisions sur 100. Quand tu feras tes 10 erreurs, je ne t’en voudrai pas. J’en aurais moi-même fait 5. Et pour les 5 autres, c’est la responsabilité que je prends. »
C’est cela être le responsable de quelqu’un : ce n’est pas repasser derrière constamment. C’est laisser travailler, et accepter comme petite contrepartie la responsabilité d’une erreur de temps à autre.
Et puis pour limiter les risques, on peut mettre un montant sur cette autonomie : « je te laisse trancher sans me consulter tout ce qui coûte moins de 50€ à régler ». Progressivement, on peut augmenter le montant : « tranche seule tout ce qui coûte moins de 100€, 200€, 500€, etc »… c’est fou le nombre de situations qui n’engagent finalement pas plus que des petits montants.
Moralité, au bout de quelques semaines, le manque de confiance avait disparu et quand je rentrais tout avait été géré ou presque. Y a-t-il eu quelques erreurs plus graves que d’autres ? Oui, de temps en temps. J’ai pris le téléphone et j’ai réparé ça en 10 minutes.
Y a-t-il eu des erreurs irrattrapables ? Je n’en ai absolument aucun souvenir. C’est donc qu’il n’y a rien eu de gravissime.
Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Ayant développé la relation de confiance avec mon alternante, lui ayant permis d’acquérir cette expérience chaque lundi, nous avons pu bâtir la suite. Quand elle venait me voir avec un problème le mardi, mercredi, jeudi ou vendredi, je me suis mis à lui dire : « si on était lundi, tu règlerais ça comment ? ».
Aujourd’hui ma jeune alternante de 2013 est mon bras droit. Elle est Responsable des Opérations et gère quotidiennement 8 salariés, avec beaucoup d’aplomb. Et surtout, elle a complètement fait sienne cette façon de fonctionner, en accordant à son tour à d’autres la confiance dont elle a bénéficié.
C’est une vraie culture de la confiance qui s’est installée. C’est beaucoup plus puissant que des consignes.
C’est sans doute ce qu’on appelle aujourd’hui le « management bienveillant »… on n’avait pas de mot pour ça il y a quelques années. C’est juste être pragmatique, confiant et tolérant.
Vaincre le manque de confiance est le seul moyen que j’ai trouvé pour faire face au développement de mon activité sans devenir dingue.
Car une fois que tes collaborateurs ont pris cette confiance à bras le corps et se sont pleinement approprié leur job, tu peux compter sur eux en toute circonstance : déplacements, congés, pépin de santé… tu n’es plus indispensable.
Et si c’était là que ça coince, chez beaucoup de chefs d’entreprise ? La peur de ne plus être indispensable.
On en reparlera dans un prochain article.
Sur ce sujet du micromanagement par manque de confiance, on a fait ce petit flashback sur la création de ton entreprise, comme une véritable extension de toi-même, de tes convictions, de tes méthodes. On a vu à quel point cela a pu peser sur ta façon de transmettre des consignes.
Pense à la dernière situation dans laquelle tu as fait preuve d’un manque de confiance envers un de tes salariés. Demande toi si vraiment il n’est pas digne de ta confiance ou s’il n’y a pas, dans cet exemple précis, un vieux reste de maniaquerie, un zeste de « ma façon à moi est la meilleure » pas forcément justifié ?
Si tu le souhaites, reviens donc nous en parler en commentaires ci-dessous ou envoie moi un mail.


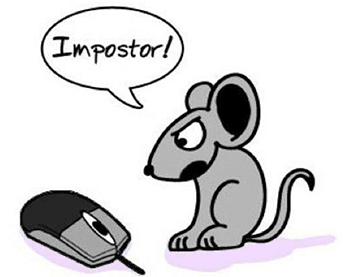

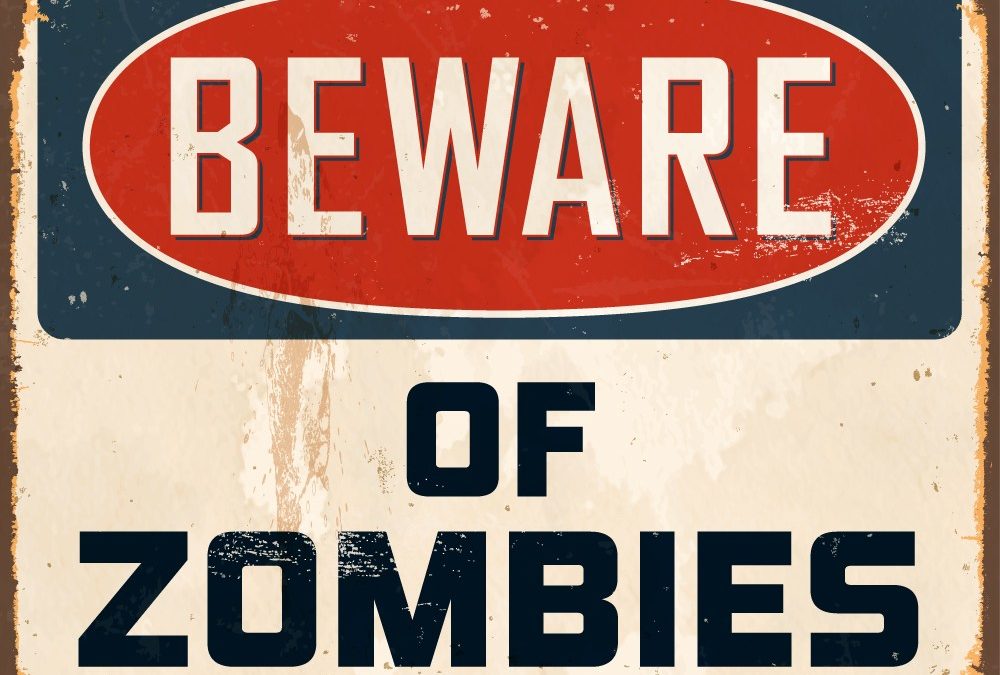
Commentaires récents